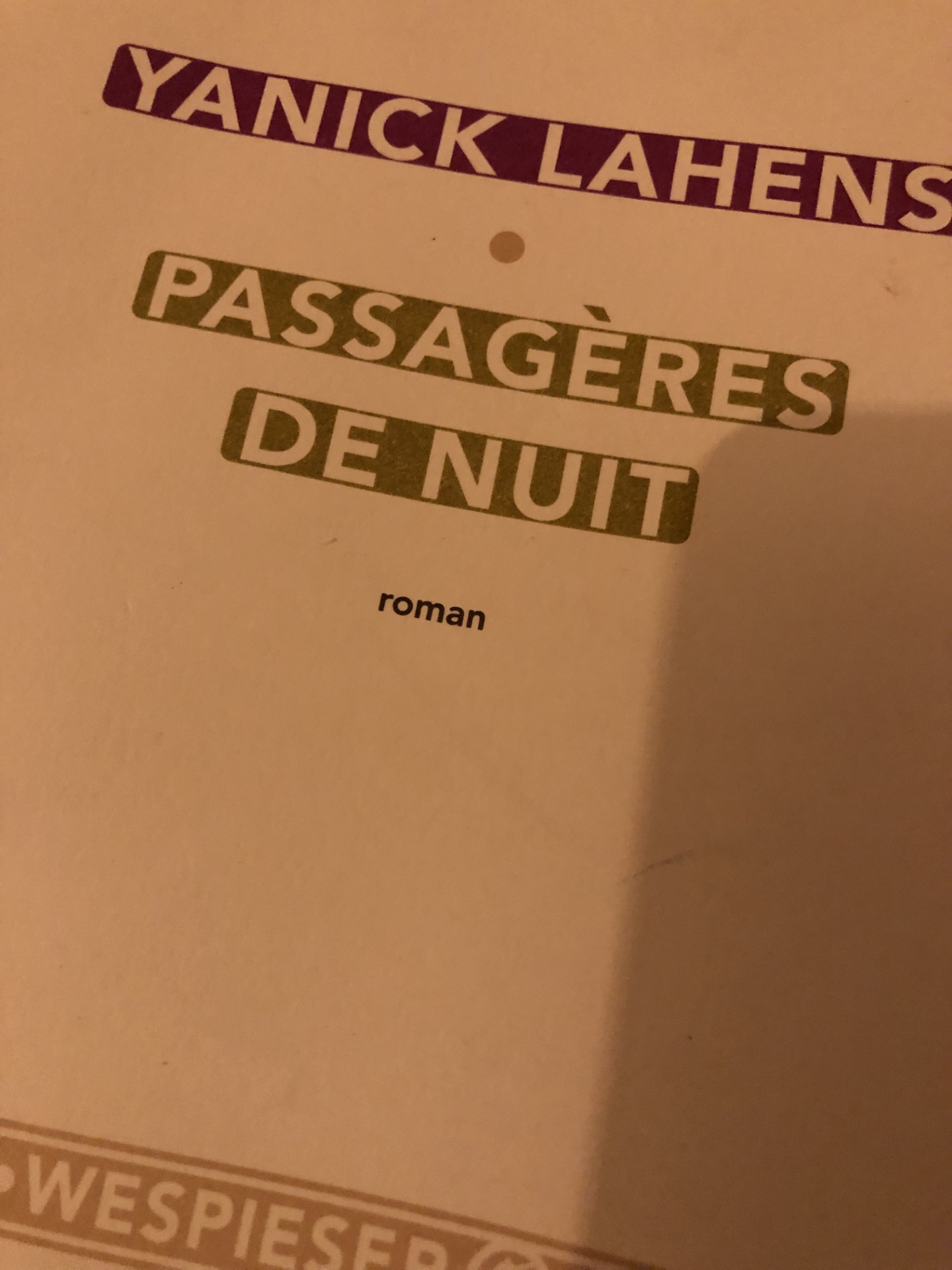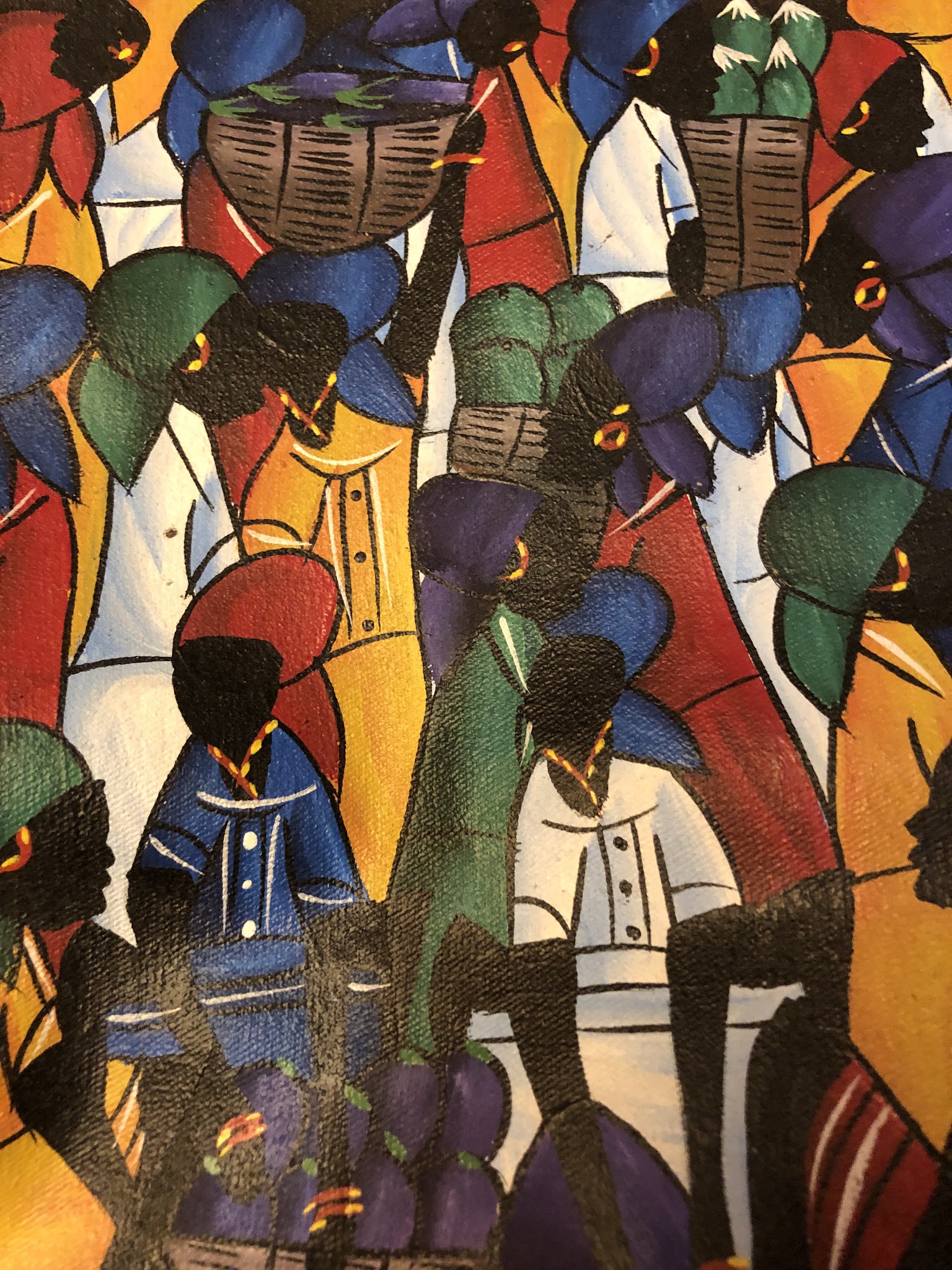Les visites de Yanick Lahens ne sont pas fréquentes et on les savoure d’autant plus. Il ne s’agit pas de les rater. Elle est donc venue à la rencontre de ses lecteurs avec un nouveau livre Passagères de nuit, qui prend place en grande partie dans une période de l’histoire du pays qui n’est pas très souvent ni étudiée, ni inspirante, en l’occurence la première partie du 19ème siècle, une période d’instabilité qui fait suite à la guerre victorieuse contre le colon français et les armées napoléoniennes qui avaient tenté sans succès de reprendre la colonie aux insurgés.
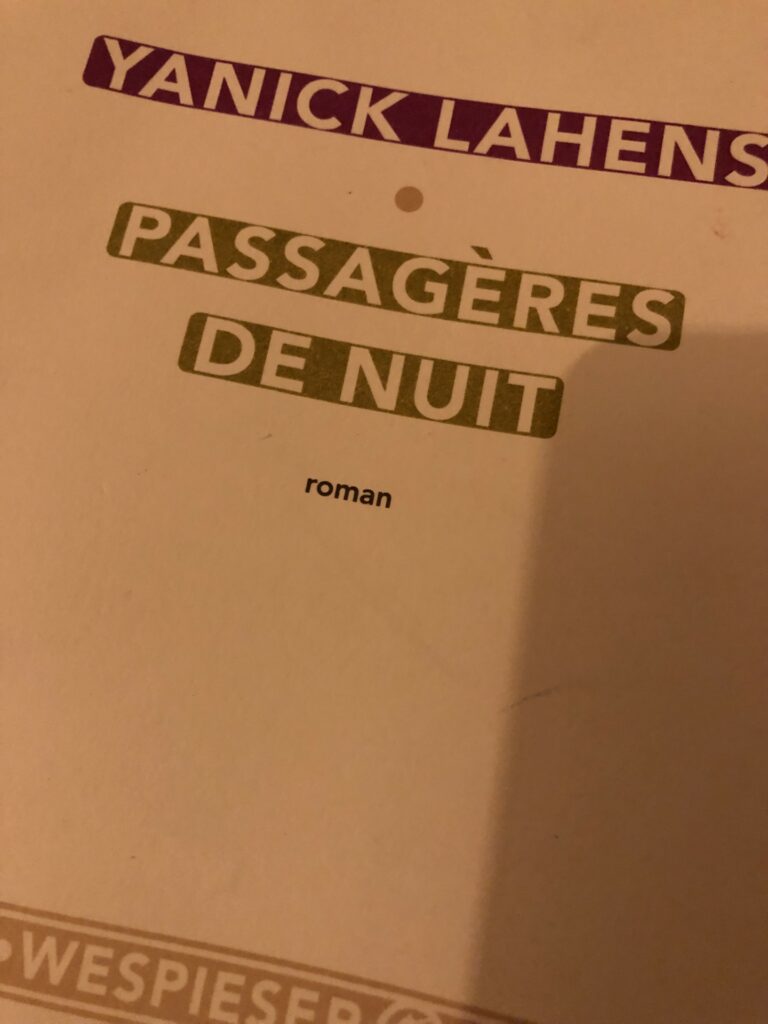
Dans ce même temps, de guerre civile, de nombreux maîtres ont fui vers la Nouvelle Orléans. Les liens entre l’ile et la ville n’ont jamais cessé et c’est dans ce contexte que l’histoire au féminin prend pied. La deuxième partie du roman reprend vers 1871 avec la deuxième passagère de nuit.
« À son arrivée à la Nouvelle Orléans, Prosper Verdun Dubuisson avait installé grand-mère à Tremé, le quartier des Noirs, dans cette modeste maison qu’il avait louée d’un créole arrivé une dizaine d’années plus tôt de Saint-Domingue et qui avait amassé une fortune conséquente dans la contrebande et le trafic de peaux avec les Indiens Chitimachas. L’affaire fut négociée lors du dernier passage du marchand au Cap-Français. Sentant que les évènements n’allaient pas tourner en leur faveur, beaucoup de colons se préparaient dans la précipitation leur départ de Sint-Domingue. Verdun-Dubuisson avait préalablement fait l’acquisition d’une plantation entre la Laura Plantation et la plantation de Saint-Joseph pour faire pousser le coton et maltraiter à nouveau les Noirs. Puis celle d’une demeure non loin de Garden District, où il séjournait une partie de l’hiver avec sa femme et ses deux fils. Il est mort l’année où ma mère a eu ses dix ans. » (p.84/85)
« Il me rappela en riant cette rencontre heureuse. « Je l’ai poursuivie et je la poursuis encore ». Comme lui, j’avais appris à aimer ce lieu où tout ce qui constituait le creuset de La Nouvelle Orléans se mélangeait, les familles créoles aristocratiques, les réfugiés e Saint-Domingue, les esclaves, les affranchis, les Amérindiens et les Américains arrivés du nord. Sur cette allée du quai, Trémé se confondait à Marigny, le Vieux Carré au Nouveau Marigny. » (p.106)
L’écriture de ce roman prend place dans un contexte difficile dans le pays d’Haïti. Yanick Lahens n’a pas pu rentrer chez elle pendant dix mois et comme elle l’a dit l’écriture de ce roman et le choix de ce thème lui ont probablement permis de surmonter cette épreuve (qui n’est pas terminée). Mais par des chemins de traverse au moins a-t-elle pu rentrer. Ce qui est intéressant et savoureux aussi, c’est que dans cette oeuvre l’autrice utilise davantage le créole que par le passé en intercalant des expressions ou des bouts de dialogue de cette langue chantante et imagée, laissant entrer davantage le lecteur dans la réalité du pays, puisque le créole est la langue maternelle de la quasi-totalité du pays mais le français y vit encore en tant que langue officielle et avec cet accent si particulier et si charmant.
« Nous étions fourbues, affamées, mais mère avait laissé entendre que nous n’étions pas au plus mal. Pas plus plus mal, pa pi mal, c’était une des nuances du « oui » qui n’est pas un oui, mais une manière de garder les souffrances pour nous. « Oui ». Une dernière parade de la dignité, un art du secret. Une manière pour nous de tenir à distance ceux et celles qui nous infligent le malheur. » (p.140)
Et puis, bien sûr, on sent à travers le récit le lien toujours présent avec notre époque, comme à travers les catastrophes naturelles qui endeuillent régulièrement la cité de Port de Prince. On ne peut s’empêcher de penser au tremblement de terre de 2010. Mais elle-même bien consciente de cela, nous l’a confirmé lors de la discussion.
« Man Jo arrêta son récit pour réfléchir tout haut: « Seules les catastrophes font battre cette ville d’un même coeur qui saigne. Seules catastrophes! » » (p.174)
Au fond ces contrées américaines, sans être refoulées, la Nouvelle Orléans et Saint-Domingue/Haïti font aussi partie de l’histoire de France. ce qui me paraît évident également c’est qu’à travers l’oeuvre de Yanick Lahens, aux éditions Sabine Wespieser, on a une belle collection qui raconte une épopée haïtienne contemporaine.